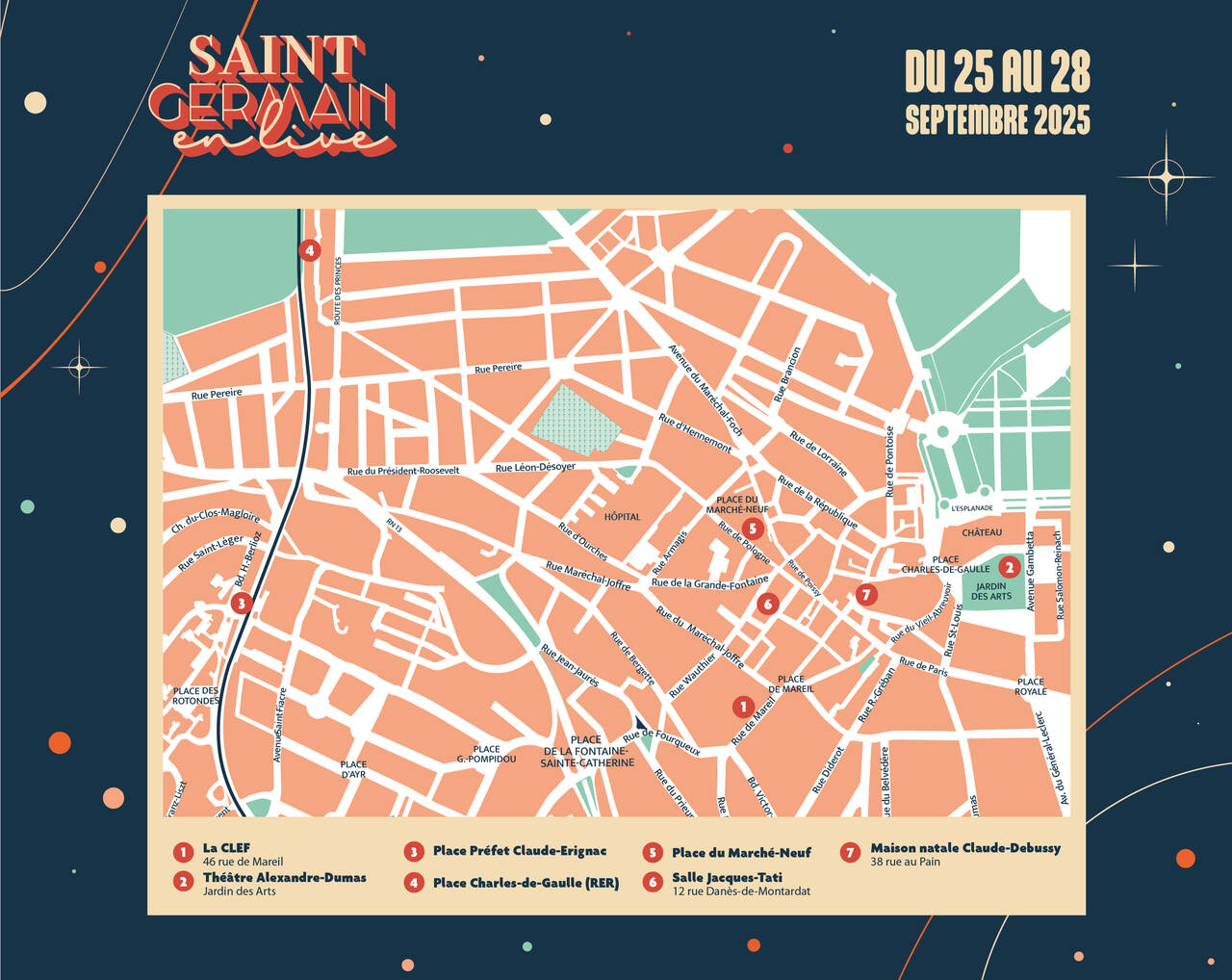Les lieux
Se restaurer
Profitez du cadre du Jardin des Arts pour vous restaurer !
- Le café des Arts
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h et le dimanche de 10h à 15h30
Site internet
- Le Foodtruck « Paradox Urban Smoker »
Ouvert de 18h30 à 23h, du jeudi 25 au samedi 27 septembre.